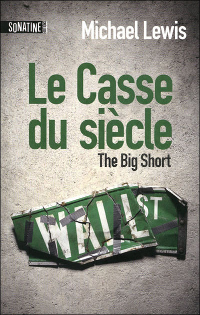Article remanié écrit par Bruno Sedran et première publication dans Pro J, n°7, septembre 2013.
A l’heure où la précocité est devenu un modèle éducatif, la focalisation parentale sur l’apprentissage de la lecture de plus en plus tôt en est un exemple, il n’est pas étonnant de voir la question de l’enfant à haut potentiel revenir régulièrement interroger le milieu scolaire. Si au niveau du QI, un enfant est considéré comme étant à haut potentiel à partir de 125-130 de QI total, c’est surtout parce qu’il y a une véritable souffrance de l’enfant – et non pas qu’il est premier de classe – que les parents consultent un professionnel. Cette souffrance s’exprime par des résultats scolaires aléatoires, une hypersensibilité, un malaise lors de l’inscription dans une classe, une école, un groupe d’amis, des angoisses, des intérêts qui semblent en décalage avec l’âge de l’enfant, etc.
Les test du QI
La question de l’anormalité infantile, de son repérage et de son identification est intrinsèquement liée au phénomène de la scolarisation. Dans le milieu de l’éducation, l’idée était au départ que la classification permettait de mieux répartir les enfants dans les institutions éducatives, de soins ou d’éducations spécialisée, dans les filières ou dans les classes. C’est en 1904 qu’Alfred Binet et son collaborateur Simon inventèrent l’échelle métrique, l’ancêtre du QI. L’objectif était de tester un assez large échantillon d’enfants scolarisés dans le but de mettre au point des techniques qui offraient la possibilité de dépister les potentialités et les déficiences des enfants.
Les éléments de ces premiers tests étaient de nature scolaire : vocabulaire, compréhension et des faits et des relations ainsi que le raisonnement mathématique et verbal.
Ce système de mesure de l’intelligence élaboré par Binet et Simon sera traduit et adapté par Lewis Terman et ses collaborateurs de l’université de Stanford en vue de pouvoir l’utiliser aux Etats-Unis . Les différents aménagements vont donner le test de Stanford-Binet. Ceux-ci disposent une série de six éléments distincts dans chaque test pour chaque groupe d’âge. Lorsqu’un enfant passe le test, on lui soumet l’ensemble des éléments dans un ordre croissant de difficulté jusqu’à ce qu’il ne puisse accomplir aucune des tâches d’un groupe d’âge donné. La performance de l’enfant est décrite sous forme d’un score appelé quotient intellectuel. Le score est calculé en comparant l’âge réel du sujet avec son âge mental, autrement dit le groupe d’âge le plus élevé atteint lors du test. Le QI est supérieur à 100 lorsque l’âge mental est supérieur à l’âge réel. Il est inférieur à 100 lorsque l’âge mental est inférieur à l’âge réel.
Cette méthode prenant en compte l’âge mental n’est plus d’usage aujourd’hui. On compare dorénavant le score obtenu par l’enfant avec les scores obtenus par des enfants du même groupe d’âge réel. Cela veut dire qu’un QI de 100 est un QI moyen et des scores supérieurs à 100 correspondent à des performances au test supérieures à la moyenne. Les deux tiers des enfants ont des scores se situant entre 85 et 115, environ 95 % se situent dans une tranche entre 70 et 130.
L’échelle d’intelligence de Weschler pour enfant (WISC) est le test le plus utilisé de nos jours. Ce test s’intéresse à l’intelligence générale, autrement dit à l’organisation des aptitudes permettant des relations efficaces avec le milieu. Ces aptitudes étant aussi nombreuses que complexes, on y inclut des aptitudes non intellectuelles nécessaires à la réalisation de tout acte. Afin que le test évalue au mieux l’intelligence générale ainsi définie, il est composé d’une série de types de problèmes différents avec une échelle de difficulté. Ces différents types sont également divisés en deux sous-groupes : le premier vérifie l’acquisition des habilités verbales ; le deuxième vérifie l’acquisition des habilités non verbales.
Nous retrouvons donc dans ce test :
– des épreuves verbales : information, compréhension de la similarité entre les objets, arithmétique, vocabulaire, compréhension ;
– des épreuves de performances : complètement d’image, code, arrangement d’images en vue de raconter une histoire, cubes, assemblage d’objets.
Ce type d’évaluation est utilisé dans l’objectif de repérer les troubles de l’apprentissage ou le style cognitif d’une personne, c’est-à-dire ses modes d’appréhension et de résolution de problèmes. Il est d’autant plus utilisé à l’heure actuelle qu’il offre la possibilité de prendre certaines décisions relatives à une orientation (vers l’enseignement spécialisé, par exemple). Il est important de souligner que le résultat peut correspondre à une exigence administrative et une reconnaissance de statut, que ce soit dans le milieu scolaire à travers les types d’enseignement spécialisé ou dans celui de la santé.
Cette courte analyse historique des tests de l’intelligence permet de rendre compte que ceux-ci sont organisés en fonction de critères pédagogiques mais surtout que c’est à partir du langage que sont ordonnés les repères.
Détour par la théorie de la médiation
Si le repérage de certaines déficiences au niveau des processus logiques de l’enfant semble avoir une pertinence en vue d’organiser un enseignement adapté qu’en est-il lorsque ce type d’évaluation met en avant une relative facilité à la résolution de l’ensemble des tests et conclu par le diagnostique d’enfant à haut potentiel ?
Pour comprendre ce qui se joue derrière les processus logiques et la définition du haut potentiel, je m’appuierai sur la théorie de la médiation de Jean Gagnepain. Elle permet de saisir de manière novatrice, par l’analyse du rapport de l’enfant au langage, les capacités logiques dont l’enfant fait preuve et surtout, de préciser la spécificité de l’enfant par rapport à l’adulte.
La théorie de la médiation propose une anthropologie clinique sur la base d’une déconstruction de la rationalité humaine. La rationalité est divisée par Gagnepain en quatre plans distincts, non hiérarchiques et autonomes qui sont des principes de structuration du monde auquel l’homme s’introduit : le Signe, l’Outil, la Norme et la Personne.
Le premier plan de la rationalité est le plan de la logique dont le concept de base est le Signe. Le Signe, qui s’apparente à la capacité de langage dont dispose tout homme, se présente sous deux faces : signifiant/signifié.
Le second plan est le plan technique dont le concept de base est l’Outil, à savoir la capacité d’articuler des moyens et des fins afin que cela devienne, à travers une fabrication abstraite, des manières de faire (fabriquant) et des exécutions (fabriqué).
Le troisième plan est le plan éthique dont le concept central est la Norme qui repose sur la dialectique éthico-morale. Jean Gagnepain affirme qu’il existe une structuration du désir qui dépasse le seul principe du plaisir immédiat. Cette structuration s’appuie sur la possibilité de poser un écart par rapport au désir dans des limites préalablement posées, ce qui est appelé «manque» par les psychanalystes contemporains.
Enfin, le plan de la Personne correspond au sujet et postule qu’il n’existe de sujet humain qu’inséré dans le monde social. La Personne se présente aussi selon deux faces, la première face étant la construction d’une entité autonome, d’un sujet et la deuxième face de la personne étant la capacité de l’individu à s’inscrire dans un ensemble et à s’identifier aux autres.
Nous pouvons ici établir un lien avec Marcel Gauchet lorsque celui-ci parle de l’articulation entre le sens de la singularité (personne ne peut me comprendre, il n’y a qu’une personne comme moi) et le sens de l’anonymat de soi (je peux me mettre à la place de n’importe quel autre, je suis l’égal de l’autre, je suis un parmi d’autres). Il y a donc une nécessité de s’approprier le point de vue de l’ensemble depuis son propre point de vue : « Dans l’opération, c’est simultanément l’identité qui se décante et se forge, à savoir l’intime perception de ce qui vous met à part de tous les autres, le sentiment de l’absolue singularité de soi, mais une singularité dont on éprouve en même temps l’absolue relativité, de telle sorte que, loin de vous enfermer en vous-mêmes, elle vous en expulse et vous met en demeure de vous regarder du point de vue des autres singuliers » (Gauchet, 2004, p. 119).
Enfin, la théorie de la médiation permet de rendre compte de la spécificité de l’enfant. Si l’enfant fonctionne pleinement comme un adulte sur les plans du Signe, de l’Outil et de la Norme, il n’a pas émergé à la Personne. En effet, l’enfant se comporte comme l’adulte sur ces trois plans au sens qu’il analyse de la même manière que lui ses productions mais à sa façon : il est logique, il manipule des outils et fait preuve d’un sens moral inné. Mais contrairement à l’adulte, l’enfant ne peut s’abstraire à son vécu présent et prendre appui sur une analyse historique pour se situer. Si l’enfant fait preuve de diverses compétences, il demeure dépendant de l’adulte car il ne peut rentrer dans une réciprocité et se comporte comme s’il était au centre du monde. En effet, l’enfant n’a pas de véritable compétence sociale, avec ce que cela suppose d’abstraction de soi et de sens de l’anonymat social, et c’est précisément ces deux abstractions que le plan de la Personne permet. (Pour un développement de ces questions, j’invite le lecteur à écouter la conférence de Jean-Claude Quentel «L’enfant n’est pas une personne» donnée au CePPecs http://www.ceppecs.eu/?p=35 ou à lire le compte rendue dans la publication Yapaka http://www.ceppecs.eu/?p=59)
Le rapport à la langue
Nous venons de voir que les tests de QI étaient organisés en fonction du langage. Il est donc important dans un premier temps de faire une distinction entre la langue et le langage. La langue est l’usage du langage dans une société donnée et dans une situation sociale précise. L’enfant doit apprendre la langue de son entourage mais dispose de la capacité de langage, cela signifie que la langue s’apprend mais pas la capacité de parler.
La théorie de la médiation, en s’intéressant aux fautes de langage des enfants, montre que si la faute exprime le fait que tout enfant doit apprendre à faire fonctionner le langage dans un monde social, elle révèle également qu’il est capable de maîtriser des règles et fait preuve d’une logique. Les fautes vont révéler deux dimensions du langage.
Il existe tout d’abord des fautes dites de « généralisation ». Ce type de faute indique que tous les enfants sont capables de produire des oppositions, qu’ils classent en mettant en lien des éléments de langage les uns avec les autres et en les relativisant. Par exemple : l’enfant va appeler tous les adultes « papa » ; il va dénommer « zizi » tous les objets en forme de tubes, etc. Il ne s’agit pas d’un simple stock d’éléments mémorisés que l’enfant ressort mais d’un lexique dans lequel ces éléments ont une valeur. En effet, pour parler il suffit d’opposer deux items au sens où l’un n’est pas l’autre. Les fautes de généralisation des enfants montrent que ceux-ci possèdent une grille d’analyse mais que cette dernière n’est pas précise. L’enfant en progressant va devenir de plus en plus précis, mais dès le début son langage est grammaticalement complet : il possède un lexique et une syntaxe puisqu’il peut discriminer les termes. Lorsque l’enfant dit « papa biberon », il est capable de segmenter puisqu’il a découpé en deux unités. Il possède le principe de segmentation et donc le principe de l’unité.
Quant à la faute de type «analogie morphologique», elle témoigne d’une mise en œuvre d’une opération de type quatrième proportionnelle. Ce type de faute montre que tout enfant est capable d’établir des rapports entre ses productions et d’en faire découler des règles qui sont parfaitement logiques. Par exemple : « prendu » sur le modèle de vendre/vendu ; « j’allerai » sur le modèle de chanter/je chanterai, etc. Les rapports établis entre les termes mettent à jour la capacité d’abstraction de l’enfant même s’il est incapable d’expliquer à autrui le fonctionnement qu’il a mis en œuvre.
Ces deux types de fautes nous montrent combien l’enfant sait mettre en œuvre la caractéristique spécifique du langage qu’est la double articulation du signifiant et du signifié. Autrement dit, l’enfant possède d’emblée cette aptitude à distinguer certains éléments phonatoires permettant de distinguer du sens (du signifié) et l’aptitude de faire correspondre à des sens différents des éléments phonatoires différents (du signifiant). Comme l’exprime Quentel, il possède tant la pertinence que la dénotation : « la dénotation faisant correspondre à des sens différents une différence de marques, l’enfant doit à la fois différencier et segmenter, outre des phonèmes, des mots dont le critère est cette fois à chercher dans la structure du signifiant, seule apte à révéler l’existence d’une frontière sémiologique » (Quentel, 1997, p. 100).
Les fautes sur la quatrième proportionnelle nous permettent également de comprendre le rapport de l’enfant à la logique. Dès que l’enfant parle, il se montre logique et prouve, à travers ses productions, qu’il possède une grammaticalité c’est-à-dire la capacité d’analyser son propos en structurant le son et le sens. En effet, parler c’est choisir dans un lexique et segmenter des éléments d’un texte, autrement dit, fournir de l’unité et de l’identité. Cela ne se résume donc pas à un simple problème de combination mais au contraire nécessite de fournir une analyse logique en vue de découper du point de vue de la différence (identité) et du segment (unité) avec des critères autres que ceux qui sont fournis par l’habitude, l’usage ou les besoins mémorisés (Quentel, 1997). L’enfant produit donc bien une distinction de l’autre et du même et l’inscrit dans une logique, dans une grammaticalité.
Un enfant apprend donc plus tôt qu’on ne le pense mais on estime qu’il ne parle que lorsque son discours s’apparente à un discours d’adulte. Or, nous pouvons affirmer qu’il parle dès qu’il sait dire sans se tromper, par exemple, « papa » et « popo » car si cela ne semble pas complexe, il y a effectivement une opposition entre deux termes et donc une logique.
Nous voyons ici que parler d’un lexique plus ou moins complet n’a aucun sens car personne ne possède de lexique assez complet pour dire le monde dans sa totalité. De plus, la logique n’est pas en lien avec le degré d’élaboration conceptuel et encore moins avec le niveau de développement. L’enfant progressivement va perfectionner et complexifier son lexique.
En ce qui concerne la richesse du vocabulaire, celle-ci ne se situe pas au niveau du lexique. En effet, la complexité d’une phrase ne tient pas à la grammaire mais à la rhétorique, autrement dit à la performance à travers ce dont on parle et ce qu’on en dit, le thème et le propos (Gagnepain, 1994). Ces éléments sont en lien avec le niveau du locuteur du point de vue de la langue.
Nous venons de voir que le langage et la langue ne situent pas au même plan. Le langage se situe sur le plan de la logique (le Signe) et la langue trouve son principe d’explication dans l’appropriation que l’homme, en tant que personne, fait de son histoire. Ce qui fait la langue c’est la capacité qu’a l’homme de s’approprier le langage par l’appropriation à la fois de l’échange (niveau de la singularité) et de la communication (niveau de l’universel). Donc nous pouvons dire que la langue est une appropriation du langage mais ce dernier n’y intervient que comme contenu particulier : «Pour être humain, il ne suffit pas de disposer de cette capacité de langage qui nous fait locuteur ; il faut encore la mettre en oeuvre dans des relations et s’instituer interlocuteur» (Quentel, 2006, p.112) Ce qui est donc en jeu, c’est la dialectique de la Personne qui implique que la langue est un parler avec un certain nombre de règles grammaticales et un vocabulaire mais est aussi une inscription dans une culture, un savoir comme en témoignent les proverbes ou encore la compréhension de l’humour.
Si comme le précise la théorie de la médiation, l’enfant n’a pas émergé à la Personne, comment expliquer son rapport à la langue ?
Quentel nous précise que l’enfant est dimension de la Personne pour et par l’autre. Autrement dit, il participe de la Personne par procuration de l’adulte. L’enfant est inscrit dans le monde non pas pour l’avoir choisi mais pour le recevoir du parent dans l’histoire de qui il se trouve inscrit. Il participe donc du social par procuration. Pour le dire autrement, l’enfant ne sait pas prendre en charge la responsabilité pour autrui, il se construit sur les repères de l’adulte car il ne peut relativiser ou véritablement contester ce rapport à l’adulte. En effet, il ne sait pas prendre en compte la réalité d’autrui et s’inscrire dans le registre de l’altérite. Le parent s’engage pour l’enfant en assumant les tâches sociales de la société auquel il participe et dans laquelle il doit introduire l’enfant. Le parent s’inscrit dès lors en l’enfant comme idéal du Moi, comme modèle identificatoire qu’il représente par la maîtrise de sa condition. Mais pour le parent, l’enfant incarne également son idéal du Moi par le simple fait qu’il représente toujours une potentialité, une ouverture à l’ensemble des possibles. Cette indétermination que représente l’enfant est d’autant plus importante qu’elle est aujourd’hui socialement valorisée.
Pour revenir au niveau de la distinction de la langue et du langage chez l’enfant, nous pouvons dire que ce dernier tire sa langue du parent mais il en fait son affaire au sens où il est doué de logique et peut donc en tirer d’autres conséquences. L’enfant s’imprègne des manières de voir et de faire de son entourage mais ne peut prendre de distance avec les opinions et les usages de celui-ci. En d’autres termes, l’enfant s’imprègne des points de vue auxquels il se trouve confronté mais ne peut pas les relativiser. Nous en revenons une nouvelle fois à la spécificité de la langue : l’enfant s’imprègne de la langue de son entourage. C’est en ce sens que l’on parle de « langue maternelle ». Il s’imprègne d’une langue qu’il ne peut opposer à aucune autre. C’est pourquoi un enfant jonglant avec différentes langues doit être considéré comme diglosse et non comme bilingue. Le bilinguisme se définissant comme étant la capacité de manier deux langues ; la diglossie étant le fait de manier ce qui est vécu par l’adulte comme deux langues. Pour l’enfant, il n’y a pas de véritable différence entre ces deux langues, ce ne sont qu’une complexification de registres différents à l’intérieur d’un même système (le langage). Jean-Jacques Rousseau l’avait déjà compris : « je ne crois pas que, jusqu’à l’âge de douze ou quinze ans, nul enfant, les prodiges à part, ait jamais vraiment appris deux langues (…) il ne peut donc apprendre à parler qu’une langue. Il en apprend cependant plusieurs, me dit-on : je le nie. J’ai vu de ces petits prodiges, qui croyaient parler cinq ou si langues. Je les ai entendus successivement parler allemand, en termes latins, en termes français, en termes italiens ; ils se servaient à la vérité de cinq ou six dictionnaires, mais ils ne parlaient toujours qu’allemand. En un mot, donnez aux enfants tant de synonymes qu’il vous plaira : vous changerez les mots, non la langue ; ils n’en sauront jamais qu’une » (Rousseau, J-J (1762). L’Emile. pp. 134-135 cité par Quentel, 1997, p. 244.)
Mais pour qu’il y ait imprégnation, il convient d’ajouter que l’enfant doit avoir autorisé une certaine forme d’autorité aux personnes ou au milieu dont il s’imprègne.
Le haut potentiel en question
Dans notre société, l’enfant est aujourd’hui investi très précocement dès sa conception. Cela va inspirer un discours social sur les compétences de l’enfant. Un discours qui préconise que l’enfant est naturellement doué de capacités. Il lui faut donc de bons éducateurs aptes à l’éveiller, à le stimuler, à déceler cette masse d’intelligence et de capacités qui ne demandent qu’à s’exprimer. L’enfant est postulé comme sujet mais est aussi objet du désir de ses parents, dans un tout autre sens que le désir freudien (Lire à ce propos : Marcel Gauchet, L’impossible entrée dans la vie, Yapaka 2008. Disponible en ligne : http://goo.gl/f8IAin ).
Comme l’exprime Gagnepain, les enfants à haut potentiel sont les produits de leur milieu. Tout d’abord parce que, comme nous l’avons vu plus haut, les tests du QI s’inscrivent dans une histoire et une culture, tout en s’articulant autour du langage. Ensuite, parce que dans la mesure où tout parent pratique même sans le vouloir un adultocentrisme, il contraint l’enfant à devenir ce que l’adulte est puisqu’il est l’idéal de ce que l’enfant va devenir. Cette soumission de l’enfant à l’histoire que pour lui ses parents représentent, est dans certaines situations instaurée d’une manière telle que pour peu que l’enfant s’y prête et qu’il possède les capacités logiques, il apprend tout par automatisme. En effet, l’inscription de l’enfant dans l’histoire du parent fait que, même si on reconnaît que l’enfant sait parler sans l’apprendre des parents, il ne peut manifester sa capacité de langage que dans la langue du parent. Les capacités logiques de l’enfant vont s’exprimer à travers cette inscription dans l’histoire de l’autre. Donc tester un enfant, c’est aussi rendre compte de ce que les parents lui apportent. Mais notons qu’il faut distinguer l’enfant trop stimulé et forcé par des parents empreints de compétition sociale, de l’enfant réellement à haut potentiel. Si d’un côté, il peut apparaître une apparente forme de précocité qui s’estompera avec le temps, de l’autre les enfants conservent une bonne capacité intellectuelle (Marcelli, 2009, p. 207).
Revenons à ce qui fait la distinction du langage et de la langue. Prenons un exemple donné par Gagnepain (1994, p.115) : Dans le test de Weschler, on demande à l’enfant de dire ce qu’est une « espagnolette ». L’enfant répond « une petite espagnole ». La réponse est considérée fausse. Mais il convient de se demander ce qui est mesuré ? Est-ce la capacité logique d’établir des rapports grammaticaux, de ce point de vue, « espagnolette » est à « espagnol » ce que « maisonnette » est à «maison». Ou mesure-t-on le degré d’information dont l’enfant dispose par rapport à la langue du milieu qu’il fréquente ? Nous pouvons donc en conclure que sont deux modalités rationnelles d’ordre différent : l’une s’attache à la dimension du Signe (la logique), l’autre à la dimension de la Personne. C’est précisément cette raison qui rend les tests de vocabulaire artificiels « dans la mesure où ils sont coupés de toute désignation et exigent d’opérer hors situation, en dehors de toute relation avec une expérience » (Quentel, 1997, p. 103). Il est donc important de rappeler que les test du QI ne sont pas une mesure d’un potentiel réel d’un enfant mais bien de son expression qui dépend tout autant de l’environnement et de la motivation de l’enfant. Le score du QI est un élément à placer dans le cadre d’un travail clinique. Comme le souligne Daniel Marcelli (2009, p. 192), « l’importance des facteurs socio-culturels n’est plus à démontrer : les enfants des classes socio-économiques aisées ont statistiquement un QI plus élevé que ceux des classes défavorisées. » Le QI varie donc en fonction des conditions éducatives. Mais il convient de préciser que ce n’est pas seulement la culture des parents qui joue un rôle dans cette forme de transmission mais aussi la qualité des échanges. C’est notamment ce que nous apprend la recherche d’Annette Lareau, qui s’appuie sur une analyse comparative des styles parentaux d’éducation en fonction du milieu social. Son constat est que dans les milieux favorisés, les parents ont un style éducatif qui prépare leurs enfants à se mouvoir dans le monde des institutions et dans le monde des adultes. Ce style éducatif se traduit par un encadrement serré et une intervention active mais sans être autoritaire « à tel point que ces enfants, dit l’auteur, semblent plus vieux à dix ans que leurs camarades des classes populaires. » (Blais, 2008, p. 10) Tout l’intérêt de cette étude réside dans le fait qu’elle expose que la réussite scolaire n’est pas seulement tributaire du lien entre famille et école en termes de capital culturel partagé. Les parents issus d’un faible niveau d’instruction peuvent également adopter un style éducatif similaire.
Faire la distinction entre les plans du Signe et de la Personne offre également la possibilité de ne pas tomber dans un adultocentrisme vis-à-vis de l’analyse des réponses de l’enfant. Une autre manière de comprendre cet adultocentrisme nous est offerte par le rapport de l’enfant à la technique. Lorsque l’enfant dessine, il ne dessine pas en perspective mais reproduit l’ensemble des éléments à plat sur la feuille de papier. Juger sur ce point que le dessin de l’enfant est faux ou non conforme à la réalité serait méconnaître que la perspective est une technique de représentation de la réalité formalisée à l’époque de la Renaissance. La perspective est donc bien un point de vue culturel sur le monde.
Il convient de rappeler que tous les enfants à haut potentiel ne ressentent pas un mal-être tant au niveau affectif que scolaire. La problématique n’est donc pas le haut potentiel en soi mais bien de comprendre l’origine du trouble que certains de ces enfants peuvent ressentir.
Nous avons évoqué ce bain de culture qui tend à individualiser l’enfant de plus en plus tôt. Ce phénomène social exhorte les parents d’aujourd’hui à développer le plus rapidement possible une autonomie qui n’existe pas précisément parce que l’enfant n’a pas les moyens de l’assumer. Dès lors, la souffrance de certains enfants à haut potentiel ne serait-elle pas liée au fait que leur rapport au monde est dirigé vers la maîtrise du réel ? Nous postulons que ces enfants vivent une tension psychique entre une volonté d’indépendance qui s’exprime par une soif de connaissance et une dépendance inconsciente qui peut se traduire par une opposition aux autres, des crises de colère en cas de frustration ou une rage d’apprendre car ils font l’expérience qu’il n’y a pas assez de mots pour dire le monde.
*
Grâce à la théorie de la médiation, nous pouvons voir combien il peut être artificiel de définir les potentialités d’un enfant sur base d’un test du QI. En effet, le parent se situant dans l’enfant comme idéal du Moi, l’enfant ne peut que s’y soumettre puisqu’il ne peut témoigner de sa propre compétence que si l’occasion lui est donnée par l’inscription dans une langue, un style et un code auxquels il n’est pas encore capable d’adhérer. Les parents lui imposent ce qu’ils sont en l’inscrivant dans une histoire. L’enfant malgré ses capacités logiques ne peut exercer sa capacité de langage, comme nous l’avons vu, que dans la langue du parent c’est-à-dire dans une forme organisée socialement et que lui impose l’adulte. Il en est de même pour la technique, l’outil et la norme. Dès lors, un travail clinique doit être réalisé afin de comprendre les troubles que peuvent présenter ces enfants.
En tenant compte des transformations historiques et sociales contemporaines, nous pouvons avancer l’idée que la souffrance ressentie par certains enfants à haut potentiel se caractérise par ce conflit intérieur entre une volonté d’indépendance et le sentiment de dépendance qui structure notre rapport au social (Lire à ce propos l’article de Jean-Marie Lacrosse, La personnalité contemporaine et l’état-limite : de curieuses similitudes http://www.ceppecs.eu/?p=1207 ). L’origine de la souffrance est bien subjective et psychologique mais la posture éducative contemporaine entre en raisonnance avec la psychologie de l’individu. Dès lors, sans cesse définir l’enfant par son statut de «haut potentiel» accentue l’idée fausse que l’apprentissage n’est qu’un pur désir d’accomplissement de l’ensemble des potentialités d’un sujet à travers son activité autonome.
Bibliographie
Bee, H., Boyd, D. (2003). Psychologie du développement – les âges de la vie. 2ème édition. Bruxelles : De Boeck.
Blais, M.-C. (2008). L’éducation est-elle possible sans le concours de la famille ? Bruxelles : www.yapaka.be « Temps d’Arrêt ».
Gagnepain, J. (1994). Leçons d’introduction à la théorie de la médiation. Louvain-la-Neuve : Peeters.
Gauchet, M. (2004). L’enfant du désir. Le débat, 132, 98-121.
Gregroire, J. (2005). L’évaluation de clinique de l’intelligence de l’enfant – Théorie et pratique du WISC-III. Sprimont : Mardaga.
Marcelli, D. (2009). Enfance et psychopathologie. Paris : Masson.
Quentel, J.-C. (1997). L’enfant : problèmes de genèse et d’histoire. Bruxelles : De Boeck université.
Quentel, J.-C. (2001). Le parent : responsabilité et culpabilité en question. Bruxelles : De Boeck universités.
Quentel, J.-C. (2004). Penser la différence de l’enfant. Le débat, 132, 19-20.
Quentel, J.-C., Duval, A. (2006). L’autonomie de l’éthique. Le débat, 140, 106-125.
Quentel, J.-C. (2008). L’enfant n’est pas une personne. Bruxelles : www.yapaka.be,«Temps d’Arrêt».