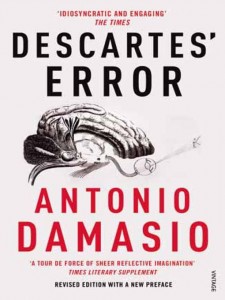Note : Ce texte est une discussion critique de l’entretien que nous a fait parvenir notre ami Claude Zylmans et que nous reprenons ci-dessous.
D’origine portugaise, Antonio R. Damasio est professeur de neurologie, de neurosciences et de psychologie. Il est directeur de l’Institut pour l’étude neurologique de l’émotion et de la créativité de l’Université de Californie du Sud depuis 2005. Ses ouvrages, qui témoignent avec clarté de ses recherches, sont publiés en français chez Odile Jacob; les deux plus importants, aux titres explicites, sont : « L’erreur de Descartes. La raison des émotions » (1995) et « Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions » (2003). Pour Damasio, qui n’a rien d’un réductionniste, c’est, en effet, le Spinoza de « L’Ethique » (et c’est là qu’il s’arrête), qui préfigure le mieux ce que doit être la neurobiologie moderne de l’émotion, du sentiment et du comportement social. L’entretien qui suit introduit bien à l’univers de recherches de cet homme passionnant et créatif, aussi éloigné des régressions comportementalistes et cognitivistes que des répétitions phraseuses psychanalytiques actuelles…
Antonio Damasio : « L’esprit est modelé par le corps »
(in larecherche.fr)
Quand vous admirez La Joconde ou écoutez l’une de vos oeuvres musicales préférées, ce n’est pas seulement votre cerveau qui est mobilisé, c’est votre corps. Émotions et sentiments, même les plus complexes, reflètent une dynamique que l’on commence seulement à explorer. Elle implique des cartes neurales qui traduisent l’activité du corps, dans toutes ses dimensions.
A RECHERCHE : Vous dites que la paramécie, avec son unique cellule, a des émotions. N’est-ce pas aller un peu loin dans l’emploi de ce mot ?
ANTONIO DAMASIO : Avec ses cils vibratiles, la paramécie perçoit immédiatement un environnement favorable ou défavorable, s’écarte vivement d’un contact que son unique cellule perçoit comme dangereux ou agressif, se rapproche de bactéries appétissantes. Ce faisant, elle exprime quelque chose comme le désir inconscient de rester en vie, de préserver l’équilibre du profil chimique de ce que Claude Bernard appelait le milieu interne. Bien que la paramécie soit dépourvue de tout système nerveux, son comportement manifeste déjà l’essence du processus émotionnel, il préfigure le monde de nos émotions. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle ressente ces émotions. Elle n’en a pas le sentiment.
Diriez-vous que la mouche, qui a un cerveau, a le sentiment de ses émotions ?
ANTONIO DAMASIO : Probablement pas. Une mouche en colère a l’émotion de la colère, elle n’en a sans doute pas le sentiment. Il y a un hiatus entre l’ensemble de réponses réflexes bien orchestrées que constitue une émotion et le fait de former des représentations cérébrales au sujet de cette émotion. Pour que le sentiment d’une émotion se crée, il faut un cerveau plus compliqué. Celui d’un chien ou d’un chat, par exemple.
Cela veut-il dire qu’un chat, ou un chien, a conscience de ses émotions ?
ANTONIO DAMASIO : Avoir le sentiment d’une émotion n’implique pas qu’on en ait conscience, si par conscience on entend, dans ce cas, le fait de savoir qu’on l’éprouve. Pour autant que nous le sachions, un chien, ou un chat, est incapable de réfléchir sur les sentiments qu’il éprouve.
Vous distinguez entre les émotions d’arrière-plan (un état d’anxiété, par exemple) et les émotions primaires, comme le dégoût ou la joie. Certaines de ces émotions sont-elles propres à l’homme ?
ANTONIO DAMASIO : Non, je ne pense pas. Toutes les émotions d’arrière-plan et primaires que nous connaissons sont probablement éprouvées aussi par un chien ou un chat, par exemple. C’est même vrai de nombre d’émotions que je qualifie de sociales, comme la sympathie, la culpabilité, la gratitude…
Donc, seules certaines émotions sociales sont le propre de l’homme ?
ANTONIO DAMASIO : Oui, et encore faut-il être prudent, tant la vie des grands singes témoigne d’émotions sociales complexes, comme l’admiration, l’envie, la fierté, l’humiliation…
Vous n’utilisez pas le mot «sensation», alors qu’il est couramment utilisé, en anglais comme en français, pour décrire des effets psychophysiologiques élémentaires mais aussi des émotions complexes, telle la joie. Pourquoi ?
ANTONIO DAMASIO : Justement parce que c’est un mot attrape-tout, qui brouille les pistes. L’intérêt du mot «émotion» est qu’il permet de distinguer clairement entre émotions et sentiments.
N’êtes-vous pas gêné par l’ambiguïté du mot anglais feeling, qui désigne pour vous un sentiment, alors que feeling est aussi utilisé pour désigner par exemple une sensation tactile ?
ANTONIO DAMASIO : Je contourne l’obstacle en définissant clairement les mots «émotions» et «sentiments» (feelings) tels que je les emploie pour les besoins de la recherche. Une émotion est, face à un stimulus, une collection complète de réponses chimiques et neurales automatiques formant une structure distinctive. Un sentiment est la transcription de cette émotion sur le théâtre de l’esprit à l’aide d’un processus conduisant à la production d’images mentales. Même si la distinction nous semble difficile à faire, nous éprouvons une émotion de tristesse avant d’éprouver un sentiment de tristesse. Divers accidents cérébraux et protocoles expérimentaux permettent au chercheur de distinguer clairement entre les deux phénomènes.
Pour décrire le processus par lequel le cerveau traduit une émotion en sentiment, vous utilisez la notion d’encartage cérébral. Que signifie cette notion exactement ?
ANTONIO DAMASIO : L’idée avait déjà été émise, de manière un peu floue, par le grand psychologue William James, voilà plus d’un siècle. Il disait que les sentiments sont une perception du corps modifiée par l’émotion. En réalité, la perception n’est pas nécessairement celle du corps lui-même, mais celle des cartes neurales construites dans les régions du cerveau qui traitent les informations venues du corps. Ces cartes sont une sorte de thermostat sans cesse régénéré. Certaines parties du cerveau sont comme un champ de détecteurs, dont les états d’activité forment une carte. À chaque instant, une collection de configurations neuronales cartographient l’état de l’organisme dans toutes ses dimensions. Face à une menace physique, par exemple, le corps réagit de manière involontaire : c’est la peur, émotion qui mobilise les muscles lisses des viscères. Ce faisant, un faisceau de signaux somatosensoriels est véhiculé par le système nerveux, mais aussi par des molécules qui passent par la circulation sanguine. Cet ensemble de signaux modifie les myriades de cartes existant à l’instant précédent.. Ce mécanisme de cartographie est complètement inconscient, mais c’est lui qui fournit le contenu des sentiments, traduction des émotions dans le domaine de l’esprit. Et bien sûr, le contenu peut devenir conscient.
Vous parlez de traduction, mais le langage n’est pas forcément impliqué ?
ANTONIO DAMASIO : Non. Je dis «traduction» au sens de «version». Un chien, ou un chat, n’a pas besoin du langage pour éprouver des sentiments. Cela me donne l’occasion de revenir sur la notion de conscience. Elle recouvre plusieurs niveaux de réalité, dont le plus simple est une sorte de sentiment élémentaire du soi, ici et maintenant. Sentiment non réflexif, mais qui est à la base des niveaux de conscience plus complexes. Un chien, ou un chat, possède certainement ce niveau de conscience, et sans doute un peu plus.
Un tétraplégique éprouve des émotions et des sentiments. Peut-on même en ce cas parler d’encartage du corps ?
ANTONIO DAMASIO : Oui, parce que même si la moelle épinière ne répond plus, il subsiste d’autres voies de transmission de l’information : le système sanguin et le nerf vague, qui transmet des informations issues des viscères, contourne la moelle et entre en contact direct avec le tronc cérébral. N’oublions pas aussi que le corps comprend la tête, dont les circuits de captage et de traitement des informations extérieures sont intacts chez un tétraplégique.
Peut-on encore parler d’encartage du corps quand les sentiments sont complexes, par exemple à la lecture de L’Éthique de Spinoza ?
ANTONIO DAMASIO : Mon hypothèse centrale est que tout ce que nous ressentons dans le domaine affectif, émotions et sentiments, est fondé sur l’activité des régions cérébrales qui sont sensibles au corps. Notre expérience quotidienne remet sans cesse à jour les cartes neurales chargées de véhiculer les informations en provenance du corps. Devant La Joconde ou à la lecture de L’Éthique de Spinoza, certaines de nos cartes corporelles se modifient. En lisant L’Éthique, j’éprouve de la joie à comprendre un passage profond, ou au contraire un malaise dû à une difficulté. Chaque fois, mon cerveau décharge des molécules associées à ces émotions, qui modifient sans que j’en aie conscience les cartes neurales associées à l’état de mon corps. Parfois l’émotion est telle que ces modifications deviennent sensibles : variations du pouls, de la respiration… Ces modifications de l’état corporel et les cartes associées sont l’objet générateur de mes sentiments. Bien entendu, ces sentiments interagissent à leur tour avec le flot de nos pensées.
Que sait-on réellement de l’encartage cérébral de sentiments complexes ?
ANTONIO DAMASIO : Peu et beaucoup. D’une certaine manière, nous en sommes au stade où en étaient les travaux de David Hubel et Torsten Wiesel quand ils menèrent les premières expériences sur les bases neurales de la vision, dans les années cinquante. Malgré tout, les techniques d’imagerie et l’analyse des patients ayant subi certaines lésions ou stimulations précises du cerveau nous ont déjà fourni une moisson d’enseignements convergents. La TEP nous a ainsi permis d’identifier des aires mobilisées par la production des sentiments en général, et de certains sentiments en particulier. Si on demande à des volontaires de générer en eux un sentiment de tristesse, en se rappelant un événement douloureux, on observe des désactivations dans les cortex préfrontaux. Certains morceaux de musique vous donnent des frissons en bas du dos ; des chercheurs ont identifié deux régions du cerveau impliquées dans ce phénomène. L’administration de naloxone supprime les frissons, ce qui semble impliquer qu’ils sont liés à la libération d’opioïdes endogènes dans ces régions du cerveau. L’étude de personnes atteintes de lésions du cortex somatosensoriel droit montre que cette région joue un rôle dominant dans l’encartage du corps. Celle d’individus atteints de lésions du cortex préfrontal prouve que cette région est indispensable à la manifestation de la plupart des émotions sociales, comme l’empathie, l’embarras, la culpabilité…
Les modèles animaux sont-ils d’une quelconque utilité pour l’analyse des sentiments complexes ?
ANTONIO DAMASIO : Oui, dans la mesure où nous pouvons étudier des comportements complexes qui, chez l’homme, sont clairement associés à des sentiments complexes. Par exemple, l’attachement parental. Si l’on bloque la sécrétion d’une hormone, la vasopressine, chez le campagnol mâle, généralement très fidèle, il ne se lie pas à la femelle après l’accouplement et ne s’occupe pas de sa progéniture. On constate le même phénomène chez la femelle, si on supprime la sécrétion d’une autre hormone, l’oxytocine.
Votre théorie de l’encartage est-elle plus qu’une hypothèse ?
ANTONIO DAMASIO : Elle me semble être une hypothèse scientifique forte. Elle est déjà étayée par un grand nombre de données et peut être enrichie et testée à mesure des progrès expérimentaux. Elle me paraît éclairer d’un jour nouveau le vieux problème, d’habitude mal posé, des rapports entre le corps et l’esprit. L’esprit est désormais envisageable dans la perspective du corps, non plus seulement dans celle du cerveau. L’esprit est meublé par le corps, il est habité par lui. Cela dit, il faut bien voir les limites de l’hypothèse. Elle ne rend pas compte de la manière dont les structures neurales deviennent des images mentales. C’est un pas vers la solution du problème de la conscience, ce n’est pas la solution.
Vous avez titré votre dernier ouvrage Spinoza avait raison. En quoi avait-il raison ?
ANTONIO DAMASIO : Sur deux points essentiels. D’abord ce qu’il appelait le conatus, mot latin par lequel il voulait évoquer un effort incessant et le vouloir-vivre. « Chaque chose, selon sa puissance d’être, s’efforce de persévérer dans son être. » Cela est valable pour la paramécie comme pour l’homme et, chez l’homme, pour une cellule comme pour l’organisme entier. En termes modernes, c’est aussi dire que toutes les dispositions de nos circuits cérébraux sont, sauf accident, programmées pour rechercher à la fois la survie et le bien-être. Un concept proche du conatus spinoziste est celui d’homéostasie : sous cet angle, les sentiments les plus complexes servent, au même titre que les émotions les plus élémentaires, à optimiser les conditions de survie. Mais le plus étonnant est la vision que Spinoza avait du problème des relations entre le corps et l’esprit. Aux antipodes du dualisme cartésien, il écrivait des phrases que je pourrais reprendre à mon compte mot pour mot. Ainsi : « L’esprit ne se connaît lui-même qu’en tant qu’il perçoit les idées des affections du corps. » Ou encore : « L’esprit humain ne perçoit les corps extérieurs comme existant en acte que par les idées des affections de son propre corps. » Et ceci : « L’objet de notre esprit est le corps existant, et rien d’autre. » Pour lui, le corps et l’esprit sont les attributs de la même substance. On le voit, les cartes neurales ne sont pas loin !
Propos recueillis par Olivier Postel-Vinay
Antonio R. Damasio
*
Cher Claude,
Merci pour tes envois toujours très instructifs. Je suis comme toi passionné par les fabuleuses découvertes de ces auteurs et par les reformulations de vieux problèmes philosophiques (comme les rapports de l’esprit et du corps) qu’elles nous imposent. Mais avant de commencer à en débattre, une précision. Pour que la discussion qui suit soit parfaitement claire pour nos lecteurs, je fais exclusivement référence à l’interview repris ci-dessus. J’y retiens, par exemple, cette phrase : « L’esprit est désormais envisageable dans la perspective du corps, non plus seulement celle du cerveau. L’esprit est meublé par le corps, il est habité par lui« . Voilà une phrase qui éclaire beaucoup de choses, notamment la difficulté croissante de mener une discussion philosophique dans un monde comme le nôtre, dominé par une conscience aussi aigüe de l’incarnation de l’esprit, de son appartenance à la chair. Car s’il s’avère que la lecture, de Damasio, de Badiou, de Spinoza, de Descombes, de Marx, de Bernstein (pas Serge, Eduard, l’auteur de Socialisme théorique et social-démocrarie pratique), de Durkheim, de Hobbes, etc, comme certains morceaux de musique « peuvent donner des frissons au bas du dos » (mais on ne dit pas quels frissons, hélas!) autant qu’ une photo de Scarlett Johansson, autant, pour les frissons, se rabattre sur Scarlett comme le fait massivement notre époque, sa silhouette fera l’unanimité et suscitera moins de tensions avec ses amis ou collègues.
Mais venons-en au fond du problème. Je commence par une question d’histoire de la philosophie, en apparence réservée au milieu des philosophes professionnels mais malgré tout capitale à mon sens. Comme je l’ai annoncé plus haut, je m’en tiens strictement à ce que dit Damasio dans l’interview ci-dessus. La définition du fameux « conatus » comme volonté de persévérer dans son être est au coeur de la philosophie de Hobbes, antérieur de plus de de 20 ans à Spinoza et dont ce dernier est un lecteur assidu. Le problème est que cette définition n’apparaît pas au chapître 11 du Leviathan, là où prennent place les fameuses formules sur le désir « allant d’un objet à un autre, de telle sorte que parvenir au premier n’est jamais que la voie menant au second » et « je place au premier rang, à titre de penchant universel de tout le genre humain, un désir inquiet d’acquérir puissance après puissance, désir qui ne cesse seulement qu’à la mort. » Ce n’est qu’au chapître 14, où Hobbes s’efforce de définir le contenu qu’il donne au droit naturel et à la loi naturelle, qu’arrive l’idée du désir comme « préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie« , définition qu’il reprend au début du chapître 17, où il résume tout son raisonnement, « La cause finale, fin ou but des humains (…) est la prévoyance de ce qui assure leur propre préservation et plus de satisfaction dans la vie ». Le désir de puissance qui engendre « la guerre de tous contre tous » n’est donc pas naturel pour Hobbes. S’il était seul, l’homme chercherait seulement à persévérer dans son être. Le désir de puissance est la conséquence du caractère temporel de l’existence humaine et de la coexistence avec d’autres désirs qui, eux aussi inquiets du futur, entrent dans une rivalité infinie, qui ne cesse qu’à la mort. De fait, cette idée est largement absente de l’oeuvre de Descartes qui, comme les anciens, assigne comme objet au désir humain l’idée de perfection. Mais il faut ici rendre a Hobbes et non à Spinoza ce qui lui appartient : l’inscription inédite du désir humain dans l’horizon de la subjectivité.
Quant au deuxième point qui est censé définir « l’erreur de Descartes », je suis sûr que l’on pourrait trouver chez Descartes -je le ferais si j’avais le temps- des phrases au sens identique à celui que relève Damasio. En effet, si le dualisme cartésien signifie la dissociation de l’esprit et du monde, c’est en fait pour renforcer son association au corps, d’où viennent les passions qui produisent illusions et aveuglements (toute notre compréhension moderne de l’illusion, de l’aveuglement et de l’idéologie comme unilatéralité de la pensée sort du Traité des passions de Descartes) vis-à-vis duquel d’ailleurs, semble-t-il, Spinoza reconnaît sa dette « Telle est, autant que je puis la comprendre, la doctrine de ce grand homme, et je m’étonnerais qu’il l’eût proposée si elle était moins ingénieuse » (Ethique, préface de la partie V).
Mais venons maintenant au coeur de l’affaire. Comment peut-on parler de l’esprit, c’est le mot utilisé par l’auteur, en faisant abstraction de la société et de l’histoire? C’est le genre de peaux de bananes que nos collègues journalistes évitent soigneusement de glisser sous les pas de ces talentueux auteurs qui utilisent des mots comme conscience, esprit, etc, sans jamais se donner la peine de les situer (où est l’esprit, dedans ou dehors?), d’en définir le cadre et le domaine exact (où sont les choses de l’esprit?), bref, d’en construire le concept. Je continue de croire que la philosophie est une chose trop simple pour être laissée aux scientifiques et aux philosophes, qui, bien que travailleurs acharnés dotés d’une intelligence supérieure, ne peuvent s’empêcher de surfer sur la vague des disciplines à la mode (et Dieu sait si la vague des neurosciences est puissante) et de rechercher ainsi le bon coup médiatique. Car enfin, quel scoop! Si Damasio avait raison contre Descartes, il aurait pris en défaut quatre siècles de philosophie occidentale comme philosophie du SUJET. De quoi acquérir d’un seul coup une célébrité de même rang que celui que l’on vient de prendre en défaut de dualisme et de monter ainsi soi-même sur le piédestal d’où l’on vient de le déloger. Or c’est bien ce que suggère ce titre grandiloquent « L’erreur de Descartes » et c’est bien ainsi sans doute qu’il sera compris en ce moment néo-scientiste où est disqualifiée toute démarche de connaissance qui ne relève pas des procédures liées aux sciences dites dures, l’expérimentation, la formalisation, la mathématisation. Sur le plan même des sciences, c’est sûr, Descartes s’est largement planté. Il n’était d’ailleurs pas un très bon scientifique même en l’évaluant à l’aune de son époque. Mais ce que nous appelons philosophie, c’est autre chose. C’est une tentative de nommer rigoureusement les expériences que nous faisons, de les communiquer à d’autres, de les situer dans un espace commun et dans une histoire commune, compatible bien sûr avec ce que les sciences découvrent tout au long de leurs incessants progrès. La philosophie moderne, à partir du 17ème siècle, est inéluctablement cartésienne parce que, poussée dans le dos par des découvertes comme celles de Kepler ou de Galilée, elle est amenée à se poser des questions que l’on ne s’était jamais posées jusque là avec autant d’acuité.
Et d’abord la question primordiale entre toutes de la « denrée mentale », pour reprendre le titre du livre de Vincent Descombes. Quelle est la matière de l’esprit? Quelle est la nature de la réalité que nous visons quand nous parlons d’esprit (et non de cerveau)? Eh bien, cette réalité, c’est ce que nous nommons familièrement le SENS. Et avant de se demander ce qui fait que les choses ont un sens, ou n’en ont pas, ou n’en ont plus, ou n’en ont pas encore, il nous faut nous demander quelles sont les conditions de possibilité du sens. C’est la question qui travaille les modernes depuis quatre siècles, c’est même, pourrait-on dire, ce qui fait de nous des modernes, fils de Descartes et Hobbes, de Kant et Hegel, de Freud et de Durkheim, bien plus et bien autrement que de Platon et Aristote, d’ Augustin et de Thomas d’Aquin. Si nous modernes sommes « dualistes », encore qu’il faudrait ici parler de dualité (ontologique) plutôt que de dualisme car bien sûr l’esprit est incarné dans la chair, c’est parce que nous savons justement qu’il est impossible d’identifier un état mental et un état cérébral et que cette impossibilité n’est pas liée à certaines particularités du cerveau, elle tient d’abord dans la différence irréductible des significations du mot « état » que le langage et le sens commun postulent. La « simple » analyse du langage nous amène à buter sur le fait de la dualité, je dis bien le fait et non de vagues spéculations. Quand je dis « ce livre », je parle de deux choses radicalement différentes selon que je désigne par là un objet culturel, ou psychique, ou un objet naturel, ou disons physique, car tout livre est évidemment un produit artificiel. Ce livre, posé là devant moi, est physiquement unique, il est le seul, même s’il y en a des milliers d’autres ailleurs mais, comme objet culturel, c’est le même livre qui existe en 100, 1.000 ou 100.000 exemplaires.
On peut se demander pourquoi il est devenu si difficile pour nos contemporains de reconnaître cette irréductible dualité du fait humain. Personne ne tentera de nier ou de réduire le caractère bi-facial d’une pièce de monnaie par exemple : elle ne se donne à voir que sous une face ou sous l’autre, ou sur la tranche, mais alors il n’y a plus grand chose à voir. C’est pourtant à partir d’une pratique intensive des sciences et de leurs fulgurantes avancées dans la seconde moitié du 19ème siècle que la pensée est finalement parvenue à s’extirper de l’univers moniste des anciens, l’univers du cosmos (dont le panthéisme de Spinoza n’est en fait qu’une version parmi d’autres). C’est la prise de conscience de cette dualité qui a été à l’origine d’une dissociation entre les dites sciences de l’esprit et les sciences de la nature (Dilthey), dissociation dont Freud, isolant le domaine du psychique, et Durkheim, isolant le domaine du social, ont été les principaux artisans. Ce domaine propre de l’humain, domaine du social-psychique, est doté de propriétés tout à fait remarquables que nous nommons communément symboliques en un sens précis : elles sont des significations qui communiquent toutes entre elles et s’inscrivent dans un processus permanent de changement et d’invention. Le livre de Vincent Descombes déjà évoqué a le mérite de faire l’inventaire de ces propriétés de la « denrée mentale » : le mental est intentionnel, holiste et impersonnel.
Mais il y a plus! Les résultats auxquels parvient la philosophie de l’esprit en utilisant les instruments logiques de la définition, de la conceptualisation et de l’autoréflexion cad d’une mise au clair de ce qui vous autorise à à avancer ce que vous avancez, sont en train d’être vérifiés par une nouvelle théorie de l’esprit qui, sur un point au moins, se rapproche des sciences dites « dures », la possibilité, via la clinique neuro-psychiatrique, de mettre en oeuvre une démarche quasi-expérimentale en sciences humaines.
Nous aurons encore l’occasion ultérieurement, dans ce blog et au CePPecs, de revenir sur cette nouvelle théorie qui nous a déjà beaucoup inspirés. Je voudrais seulement ici recommander la lecture de l’important dossier qui lui est consacré par la revue Le débat sous le titre : « Une nouvelle théorie de l’esprit : la médiation » (le débat n°140, mai-août 2006) dont j’extrais le passage qui nous concerne le plus directement ici. Il est dû au regretté neurologue Olivier Sabouraud, qui fait ressortir l’intérêt de la théorie en question au regard des deux blocages dont souffrent actuellement les neurosciences, la question du dualisme corps-esprit qui nous occupe ici et celle de la différence entre l’homme et l’animal.
Voici ce passage, assez long mais impossible à découper si l’on veut en conserver le sens : « Tout le monde rencontre le dualisme; la phénoménologie est dualiste. Depuis l’origine, les neurologues y sont confrontés, eux à qui l’on a enseigné les voies de la motricité volontaire, la dissociation automatico-volontaire, ou la localisation de la sensibilité proprioceptive consciente. La volonté et la conscience n’ont aucune définition physiologique possible; elles appartiennent à un registre de la connaissance sans passage ni communication avec celui de la physiologie. Et dans sa pratique le neurologue, quand il examine un aphasique, doit s’accommoder par nécessité de cet hiatus épistémologique, puisqu’il a affaire à des lésions dans un organe, l’hémisphère gauche, et à des symptômes dans une production de l’esprit humain, le langage. Les praticiens se débrouillent avec une sorte de théorie floue, qui postule une « correspondance » entre une certaine capacité de l’ordre humain, et le travail « sous-jacent » de quelques populations de neurones anatomiquement définies.
Dans la recherche, tout le monde élude plus ou moins ce problème (en attendant que le « progrès de la science » l’élimine, un jour, n’en doutez pas). On l’élude ou on le nie, quand, par exemple, on accepte que les concepts de conscience, de volonté ou de langage soient « intuitifs » (et qu’il n’y ait donc pas lieu de les définir); ou quand on fait du corps et de l’esprit deux « perspectives » sur une même nature de l’homme (c’est la référence à Spinoza, actuellement bien cotée dans les neurosciences, voir Antonio Damasio, Spinoza avait raison, Odile Jacob, 2003) : l’esprit n’a pour fonction que de « penser le corps », d’exprimer dans ses termes propres, dans sa « perspective », les activités et fonctionnement du corps, qui seuls comptent pour la science authentique. Une autre échappatoire consiste en une sorte de matérialisme : un état mental n’est rien d’autre qu’un instantané de l’état du cerveau, en se gardant bien de définir un état mental par rapport à un autre qui ne l’est pas; le mental est alors traité comme un « épiphénomène » et l’on ne s’occupe en fait que de l’organe; cela n’est possible qu’en évacuant systématiquement de l’objet de recherche sa spécificité (par exemple en réduisant le langage à un phénomène général en biologie, la communication). » (Olivier Sabouraud: En quête d’une théorie de l’humain, Le débat n°140, mai-août 2006, pp. 68-85)
Concluons provisoirement cette longue réfutation de Damasio : on ne dépassera valablement le dualisme de l’esprit et du corps, préalable à une possible réarticulation, qu’en reconnaissant pleinement le pluralisme ontologique, cad l’existence de niveaux de réalité qui ne peuvent se recomposer en un ensemble homogène. Ce n’est qu’au prix d’une « désorganicisation » du social et d’une « dénaturalisation » du psychisme, instaurées une première fois vers 1900 respectivement par Durkheim et par Freud, qu’ont une chance de renaître, pour de nouvelles épousailles, une sociologie et une psychologie dignes de ce nom.
Jean-Marie Lacrosse